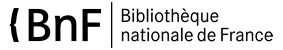Amos Gitai devant la caméra
Chroniques : Comment est né le projet du film Amos Gitai, La Violence et l’Histoire ?
Laurent Roth : Depuis ma première rencontre avec Amos Gitai en 1986, j’ai suivi ses films de très près, d’abord en tant que critique puis en tant que cinéaste moi-même. Je n’ai jamais perdu de vue son travail, qui m’a permis de rester en lien avec Israël. C’est important pour moi qui suis issu d’une famille juive et dont le père est un survivant de la Shoah. Par ailleurs, son cinéma a été une sorte de révélateur qui m’a autorisé à assumer pleinement mon identité artistique, et notamment l’hybridité entre documentaire et fiction dans mes propres films. Si Amos Gitai, depuis le film Kadosh (1997), est surtout connu du public comme cinéaste de fiction, c’est aussi un cinéaste du réel. J’ai voulu montrer que c’est à travers la dimension documentaire de ses films que l’on peut comprendre l’originalité de son œuvre.
Durant tout le documentaire, vous êtes côte à côte avec Amos Gitai, vous visionnez et commentez des extraits de ses films : pourquoi avoir fait ce choix ?
Ce dispositif permet de ralentir le temps, de revenir en arrière, de faire des pauses… Le grand écran plasma, la possibilité de s’arrêter sur des extraits, d’y entrer, permet une analyse très fine du travail de Gitai. L’idée était de mettre le spectateur devant notre confrontation, en présence réelle et en quelque sorte à égalité avec nous face au matériau filmique. Le film a été tourné en deux après-midis de trois heures. Nous avons beaucoup préparé le tournage avec Ginette Lavigne, la monteuse du film, en sélectionnant soixante-dix items ; extraits de films, dessins, manuscrits anciens et photographies tirés des collections de la BnF…
Vous présentez dans Amos Gitai, La Violence et l’Histoire des matériaux divers, des extraits de films, des rushes, mais aussi des dessins de Gitai : quel est le sens de cette hybridité ?
J’ai sélectionné des documents en lien au cinéma du réel et à la violence dans l’histoire, comme le fait Amos Gitai qui, pour chaque film, réunit des quantités d’archives, d’enquêtes et de repérages. Ensuite il taille dans cette masse. Pour lui, faire un film qui amène à réfléchir, c’est mettre ensemble des éléments hybrides, créer des rapprochements pour que le spectateur construise lui-même son interprétation. Et par moments, Gitai passe par un autre médium que le cinéma pour exprimer ce qu’il a en lui : dans mon film, pour la première fois, il commente les dessins qu’il a faits juste après avoir échappé à la mort durant la guerre de Kippour.
Comment les films de Gitai construisent-ils une mémoire à travers la création artistique ?
Le cinéma de Gitai invite continuellement les mêmes thèmes et les mêmes personnages. Il a bien connu Yitzhak Rabin vivant. Il assiste à son assassinat, qui a été pour lui un bouleversement intime, et par la suite, à la décomposition de la société israélienne. Gitai est resté fidèle à sa mémoire parce que Rabin n’a jamais été remplacé et qu’on attend encore un homme politique de sa trempe qui rassemble le pays sur le chemin du dialogue et de la paix.
Par ailleurs, avant de devenir cinéaste, Amos Gitai a été architecte. Son premier mémoire d’architecture portait sur la destruction du temple dans la Bible. Pour lui, l’espace est toujours instable, sans cesse menacé de disparition, à l’instar des frontières au Moyen-Orient et au Proche-Orient, qui sont de constants enjeux de combats. Cette perception très israélienne de l’instabilité des territoires va de pair avec la conception juive de la permanence du texte. C’est le texte dans l’histoire, la mémoire, la transmission qui donne sa permanence et sa légitimité à tout geste de construction, qu’il soit politique ou artistique. Gitai est à la fois un grand artiste, un architecte de la mémoire et un militant du combat d’aujourd’hui.
Votre film se clôt sur cette phrase de Gitai : « Dans toutes les choses humaines, il y a des contradictions. La perfection n’existe pas… »
La culture de la perfection est occidentale. Mais le judaïsme est une culture du manque, de l’inachèvement. Mon parti pris de traiter le cinéma de Gitai comme un cinéma du réel va dans ce sens. Un documentaire ne se termine pas, il n’y a pas le mot « fin », il reste ouvert.
Propos recueillis par Sylvie Lisiecki
Entretien paru dans Chroniques n° 92, septembre-décembre 2021
- Projections-rencontres autour de l’exposition Yitzhak Rabin / Amos Gitai Amos Gitai, La Violence et l’Histoire de Laurent Roth – Mardi 28 septembre 2021 | François-Mitterrand